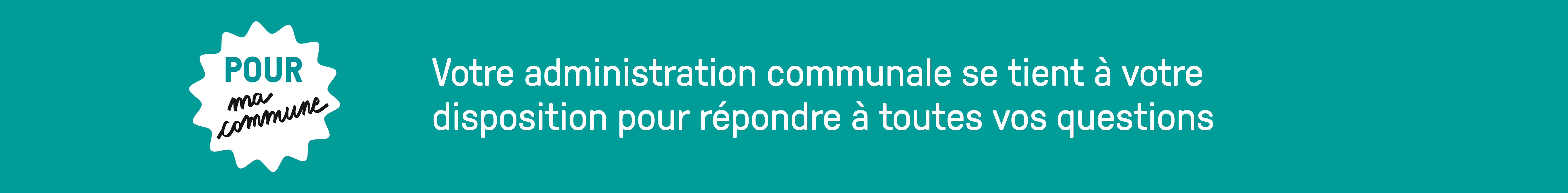Fonctionnement d'une commune
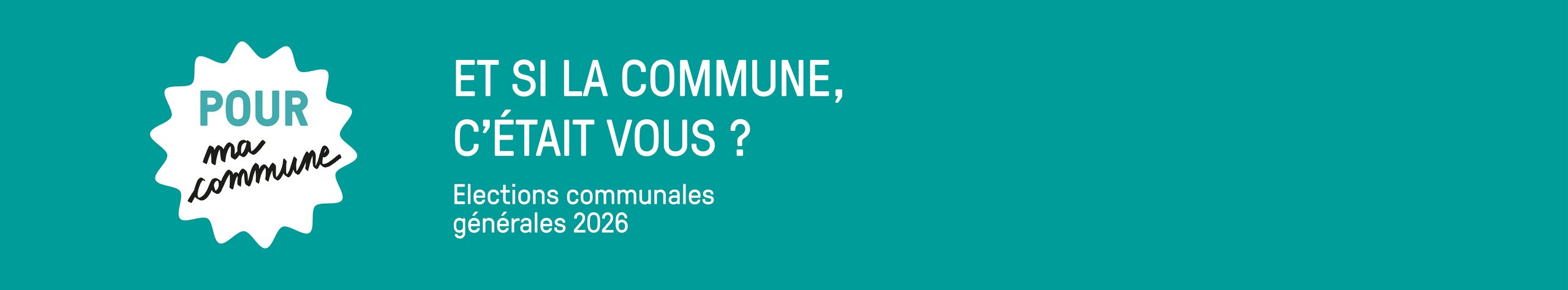
La commune est l’autorité la plus proche de la population.
Elle s'assure que la population puisse disposer d'infrastructures adaptées et d'une qualité de vie agréable.
Pour cela, elle s'occupe des routes, des bâtiments, des bibliothèques, des installations sportives, de la vie associative et culturelles. Elle offre des services tel que l'accueil préscolaire, un soutien aux sociétés locales, des animations et de l'aide pour les personnes dans le besoin.
En résumé, une commune est un acteur public du quotidien, qui fait vivre le territoire et sert directement sa population.
Elle s'organise autour des autorités communales suivantes:
- Un Conseil communal (+ de 1000 habitant·e·s) ou un Conseil général (- de 1000 habitant·e·s).
- Une Municipalité (5 ou 7 personnes élues)

Les différentes autorités communales
Le Conseil communal
Le Conseil communal (ou le Conseil général, dans les communes de moins de 1000 habitant·e·s) est le parlement local. Il réunit des citoyennes et citoyens élu·e·s pour débattre, amender et voter les grandes décisions qui structurent la vie communale : projets d’aménagement, budget, comptes, investissements, règlements ou encore fiscalité.
Être conseiller ou conseillère communal·e, c’est participer aux séances, lire les documents transmis, siéger en commission, poser des questions, émettre un avis, déposer des postulats ou des motions et, surtout, voter les propositions. C’est ainsi faire vivre un débat public et transparent au service de la collectivité.
Le rôle peut sembler modeste, mais il est essentiel, en particulier à travers deux compétences centrales :
- La compétence financière – « le nerf de la guerre, c’est l’argent ».
Le Conseil communal ou général est seul compétent pour approuver le budget annuel, contrôler les comptes et voter les crédits d’investissement. Un crédit refusé signifie qu’un projet ne peut pas être réalisé. En commission, les membres du Conseil examinent les préavis municipaux, négocient, proposent des modifications ou demandent des précisions. C’est un levier concret pour influencer la politique communale.
- La compétence réglementaire – poser le cadre légal et fiscal.
Le Conseil communal ou général adopte les règlements communaux (par exemple : règlement de police, plans d’affectation, règlements de taxes et d’émoluments, taux d’imposition, subventions). C’est lui qui définit combien les habitant·e·s paient, comment les recettes sont utilisées et selon quelles règles. Ce rôle, bien que parfois discret, est fondamental pour garantir l’équilibre démocratique et financier de la commune.
Le Conseil communal ou général est l'organe législatif de la commune. Par ses interventions, il oriente la politique menée par la Municipalité, valide ou refuse les projets et participe activement au développement de la commune. Ses compétences couvrent aussi l’aménagement du territoire, l’acquisition ou la vente d’immeubles communaux, les fusions de communes ou encore le statut du personnel communal.
En siégeant au Conseil communal ou général, vous apportez votre regard, vos questions et vos idées à la discussion collective. Vous contribuez à orienter directement les choix financiers, réglementaires et politiques qui façonnent la vie de votre commune.
La Municipalité
La Municipalité est l’organe exécutif de la commune. Elle est généralement composée de 5 ou 7 membres, élus directement par la population pour une durée de cinq ans. Selon la taille des communes, elle se réunit en principe chaque semaine afin de traiter les affaires courantes.
Son rôle est de gérer la commune au quotidien : planifier les projets, exécuter les décisions, diriger l’administration et veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des services communaux. Elle est responsable de domaines variés tels que les finances, les travaux publics, l’urbanisme, la culture, le social, les écoles, les services industriels ou encore la sécurité.
La Municipalité fonctionne de manière collégiale : les décisions sont prises ensemble, à la majorité, sous la présidence de la syndique ou du syndic. Chaque membre assume la direction d’un dicastère, qui regroupe plusieurs services et prestations à la population (par exemple : finances, routes, écoles, bâtiments, etc.).
Les membres de l’exécutif perçoivent des indemnités et vacations, dont le montant varie selon la commune. Leur traitement est fixé par le Conseil communal ou général en début de législature.
La Municipalité ne se limite pas à la gestion courante : elle a aussi pour mission de définir le développement futur de la commune et de porter les projets qui façonnent son avenir.
Être conseillère municipale ou conseiller municipal, c’est donc contribuer aux choix les plus stratégiques pour la collectivité, mais aussi acquérir une expérience précieuse en gestion, leadership et travail en équipe. Cette expérience est valorisable bien au-delà de la sphère politique : l’Association suisse des cadres propose d’ailleurs une certification spécifique permettant de faire reconnaître ce rôle comme une fonction de cadre professionnel.

Élections des autorités communales
Élection du Conseil communal
Deux systèmes existent selon la taille de la commune.
- Dans les communes de plus de 3'000 habitant·e·s
Le Conseil communal est élu au système proportionnel.
Cela signifie que chaque parti ou entente dépose une liste de candidates et de candidats (au maximum autant de noms que de sièges à pourvoir). Les sièges sont ensuite attribués proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste, puis aux candidates et candidats qui ont obtenu le plus de suffrages individuels à l’intérieur de la liste.
Si vous souhaitez vous présenter, il faut donc prendre contact avec le parti ou l’entente qui correspond le mieux à vos idées afin de figurer comme candidate ou candidat sur leur liste. L'administration communale peut vous renseigner et vous fournir les coordonnées des partis ou ententes locaux.
- Dans les communes de moins de 3'000 habitant·e·s
L’élection se déroule selon le système majoritaire. Une liste d’entente communale regroupe en général toutes les candidatures, mais d’autres listes peuvent aussi être déposées.
Ce système est ouvert à toutes et à tous : chaque citoyenne ou citoyen peut se porter candidate ou candidat librement, par exemple en s’annonçant auprès de son administration communale sans obligation d’appartenir à un parti.
- Chaque électrice ou électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de sièges à pourvoir et vote pour des personnes nommément désignées. Les sièges reviennent à celles et ceux qui obtiennent le plus de suffrages (majorité absolue requise au 1er tour).

Le Conseil général
Dans les communes de moins de 1'000 habitant·e·s, la loi prévoit l’existence d’un conseil général. Il exerce les mêmes compétences qu’un Conseil communal (budget, crédits d’investissement, règlements, etc.), mais en faire partie ne résulte pas d’une élection.
Chaque citoyenne et citoyen dispose du droit de vote communal et peut en devenir membre en demandant à être assermenté·e. Le Conseil général incarne ainsi une forme de démocratie directe locale, adaptée à la taille des petites communes : chacun participe personnellement aux grandes décisions.
Bon à savoir : certaines communes de moins de 1'000 habitant·e·s ont décidé de remplacer leur conseil général par un conseil communal.
Combien de temps ça prend ?
Être membre de la Municipalité
Cette fonction représente un engagement régulier. Selon la taille de la commune, la fonction occupe généralement 20% à 60% d’un taux d’activité, voire davantage dans les grandes villes.
Les séances hebdomadaires, les dossiers à préparer et les représentations publiques demandent du temps et de la disponibilité. Cet engagement reste toutefois conciliable avec une vie familiale et professionnelle, comme le montrent de nombreuses personnes élues qui exercent leur mandat en parallèle de leur métier et de leur vie personnelle.
Les membres de la Municipalité perçoivent des indemnités et vacations, dont le montant varie selon la commune. Leur traitement est fixé par le Conseil communal ou général en début de législature.
Être membre d'un Conseil communal ou général
Être conseiller ou conseillère communal·e implique un investissement moins significatif que celui de la Municipalité, mais qui reste important pour la collectivité. Le Conseil se réunit en moyenne 4 à 8 fois par année, selon la taille de la commune. À cela peuvent s’ajouter les séances de commissions, pour celles et ceux qui s’y impliquent : c’est là que les projets sont examinés plus en profondeur et que les conseillères et conseillers peuvent avoir le plus d’impact.
Cet engagement, bien que réel, reste parfaitement conciliable avec une vie professionnelle et familiale. De nombreuses personnens élues siègent ainsi au Conseil communal parallèlement à leur travail ou à leurs études, apportant leur expérience et leur regard de citoyenne et de citoyen.

Élection de la Municipalité
Elle est élue au système majoritaire, quel que soit le nombre de personnes résidant dans la commune.
Chaque électrice et électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de sièges à pourvoir et vote pour des personnes nommément désignées.
Au premier tour, les candidates et candidats ayant obtenu le plus de voix sont élu·e·s, à condition d’obtenir la majorité absolue (50 % des suffrages ou plus). En cas de deuxième tour, les élu·e·s sont alors désigné·e·s selon la majorité relative (le plus grand nombre de voix).
Fonctionnement entre le Conseil communal/général et la Municipalité
La vie institutionnelle d’une commune repose sur un dialogue permanent entre deux autorités :
- la Municipalité, organe exécutif
- le Conseil communal, organe législatif.
La Municipalité prépare et propose les décisions : elle élabore des projets, les traduit en préavis municipaux et les soumet au Conseil.
De son côté, le Conseil examine ces propositions, les discute, peut les amender et les vote. Ce travail s’appuie en particulier sur l’examen approfondi réalisé par les commissions.
Ce fonctionnement reflète une complémentarité des rôles : la Municipalité conçoit et exécute, le Conseil valide ou refuse et, ce faisant, oriente les choix politiques de la commune. En acceptant, rejetant ou modifiant un préavis, le Conseil peut amener la Municipalité à revoir sa copie, à réduire ou augmenter l’ampleur d’un projet, voire à modifier ses priorités.
Assurer l'équilibre de la commune
Le rôle du Conseil n’est pas de gérer “opérationnellement” la commune, mais de poser le cadre légal et budgétaire et d’orienter, par ses décisions, l’action de la Municipalité. Un bon équilibre repose sur le respect de cette répartition. Lorsque le Conseil cherche à intervenir directement dans la gestion quotidienne – ce que l’on appelle la cogestion – l’équilibre institutionnel se trouve fragilisé. La cogestion brouille les responsabilités, ralentit les décisions et crée des tensions inutiles.
En résumé, le fonctionnement entre Municipalité et Conseil repose sur un équilibre subtil : la Municipalité propose et exécute, le Conseil discute, amende et vote.
Chacun a son rôle, et le respect de cette répartition garantit à la fois l’efficacité et la clarté démocratique.
Qu'est-ce qu'un préavis municipal ?
Le préavis municipal est le principal outil de dialogue entre la Municipalité et le Conseil.
C’est un document officiel qui présente :
- le projet envisagé (par exemple, créer une place de jeux),
- les motifs qui le justifient (sécurité, modernisation, besoins de la population),
- et les implications financières (coût, financement, subventions éventuelles).
Les préavis peuvent concerner des thèmes très variés :
- un nouveau règlement communal (par ex. vidéosurveillance),
- l’ajustement d’une taxe (par ex. taxe sur les déchets),
- l’octroi d’un crédit d’investissement (par ex. rénovation d’une salle polyvalente).
Chaque préavis se termine par des conclusions, c’est-à-dire une proposition de décision.
Le Conseil se prononce sur ces conclusions : s’il les accepte, la Municipalité est autorisée à mettre en œuvre le projet et à engager les dépenses correspondantes.
Le rôle des commissions
L’influence des conseillères et des conseillers s’exerce particulièrement à travers les commissions.
Lorsqu’un préavis est déposé, une commission est chargée de l’examiner en détail. Ses membres peuvent :
- poser des questions à la Municipalité
- demander des précisions
- négocier des adaptations
- proposer des amendements
La commission rédige ensuite un rapport, qui présente son analyse et ses recommandations à l’ensemble du Conseil.
C’est une étape cruciale : les discussions en commission permettent d’affiner un projet, de faire entendre des sensibilités diverses et, parfois, d’obtenir des modifications significatives avant le vote en plénum.
Pour un·e conseiller·ère communal·e, siéger en commission est donc une opportunité concrète d’influencer : c’est là que s’exerce le plus directement la capacité de modeler la politique communale.
Les domaines d'intervention
Urbanisme et aménagement du territoire
La commune planifie son développement : logements, zones artisanales, zones agricoles, accès routiers, espaces publics.
Exemple : un projet de nouveau quartier résidentiel implique la mise à jour du plan d’affectation communal, la gestion des oppositions, la concertation avec les habitant·e·s, l’examen des impacts sur la mobilité et les écoles.
Écoles obligatoires
Les communes assurent le bon fonctionnement matériel des écoles. Elles financent les bâtiments, les équipements, sécurisent les abords, organisent les transports scolaires, etc.
Exemple : une commune peut décider de rénover entièrement un collège devenu vétuste ou d’ajouter des préaux couverts.
Accueil parascolaire et préscolaire
Les communes soutiennent l’accueil en crèche ou en UAPE. Elles peuvent aussi coordonner les horaires avec les transports ou les besoins des familles.
Exemple : une commune met en place un guichet unique pour les inscriptions et adapte les horaires d’accueil en fonction des horaires de transports des parents.
Voirie, routes et mobilité douce
Entretien des routes, sécurité piétonne, pistes cyclables : la commune gère ses infrastructures.
Exemple : réaménager un carrefour dangereux, installer des ralentisseurs, ou encore créer une piste cyclable entre l’école et les terrains de sport.
Déchets et environnement
La commune organise la collecte, le tri, la gestion de la déchèterie, et peut promouvoir la durabilité.
Exemple : une campagne communale encourage la réduction des déchets verts par compostage collectif, développement d’une déchèterie, ou encore une subvention à la pause de panneaux solaires pour les immeubles privés.
Culture, sport et vie associative
Les communes soutiennent les clubs, les manifestations et les infrastructures sportives et culturelles.
Exemple : subvention à une fanfare locale, rénovation des installations du club de pétanque, organisation d’un festival communal, ou mise à disposition gratuite de la grande salle pour les sociétés locales.
Action sociale de proximité
La commune peut soutenir les habitant·e·s en difficulté : bons alimentaires, logements temporaires, service social communal.
Exemple : un fonds d’aide d’urgence pour les familles précarisées, des activités intergénérationnelles, un foyer pour la jeunesse, des activités pour les seniors ou encore des formations sur la nutrition.
Administration générale
Délivrance de documents, tenue du registre des habitants, naturalisations, organisation des élections.
Exemple : une commune investit dans la modernisation de ses guichets pour permettre les démarches en ligne, ou organise une séance publique d’information pour les nouveaux arrivants.
Fiscalité et finances
La commune fixe son taux d’imposition, prélève des taxes, adopte un budget, décide de ses priorités.
Exemple : décider d’augmenter temporairement le taux d’imposition pour financer la construction d’une nouvelle salle polyvalente, ou maintenir un bas niveau d’imposition pour attirer des familles et entreprises.